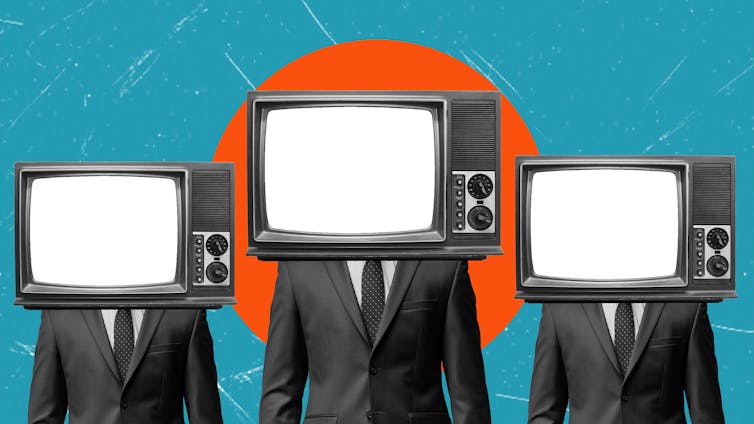
Les médias mettent en avant la vérification des faits (« fact checking ») face aux fausses informations (« fake news »). Ils questionnent moins souvent la façon dont les récits sont élaborés (« storytelling »). Quelle pourrait-être la méthode pour construire un discours journalistique objectif et impartial ?
Chacun a entendu parler des fake news, qui seraient supposément propagées par les réseaux sociaux. Nombreux sont les médias qui s’équipent de cellules de « fact checking » censées les contrer. Mais sont-elles efficaces ? Leur critère est souvent de « revenir aux faits ». Pourtant, c’est loin d’être suffisant.
Trois normes sont centrales, en réalité : l’objectivité, la neutralité et l’impartialité. Or, elles sont largement méconnues.
Comment dire le vrai ? Le problème traverse déjà les écrits de Platon, quand il dénonce la rhétorique des sophistes, qu’il juge manipulatrice. C’est encore le cas quand Socrate pointe les limites de l’écrit, qui coupe le lecteur de la réponse possible du rédacteur. L’intelligence artificielle et les réseaux sociaux reconfigurent les enjeux, étant de nouvelles manières d’écrire et d’échanger. Ils ne les inventent pas. La présence de cellules de « fact checking » est à double tranchant, dans la mesure où elles jettent aussi un doute sur la production médiatique restante. Leurs méthodes doivent-elles en effet être réservées à une émission parmi des dizaines d’autres ? Produire le vrai n’est-il pas la raison d’être du journaliste, de tous les instants ? Et les réseaux sociaux ne sont-ils pas aussi une manière d’informer sur ce que les médias dominants négligent ? A qui faire confiance, alors ? Sur quels critères ? Le problème est pratique et concret.
Vérifier les faits, oui mais lesquels ?
Face aux « fake news », la réponse la plus courante consiste à « vérifier les faits ». On parle alors de « fact checking », à l’exemple des « Vérificateurs » sur TF1. Vérifier les faits est essentiel, en effet, car certaines informations sont tout simplement fausses. Les conséquences peuvent être immenses, à l’exemple des « armes irakiennes de destruction massives », qui n’existaient pas, mais ont servi à justifier l’entrée en guerre des États-Unis face à l’Irak, en 2003. Mais ce n’est pas le seul problème. La manière dont les faits sont sélectionnés et racontés est une difficulté distincte. La sélection est inévitable, du fait des formats, et aucun choix n’est neutre.
Ne montrer que les points de deal, dans une cité, n’est pas plus neutre que de ne montrer que le chômage massif qui pousse les jeunes vers l’argent facile. La manière d’enchaîner les faits est également déterminante.
Par exemple, enchaîner les faits divers dramatiques à l’exclusion de toute autre considération enferme le public dans une histoire : celle de l’insécurité. Le besoin de sécurité peut ainsi être fabriqué, sans que l’insécurité objective n’ait changé. L’histoire ainsi construite est-elle vraie, est-elle fictive ? Il n’y a souvent pas très loin de la narration des faits au storytelling ou art de raconter à un public les histoires qu’il a envie d’entendre.
Une autre réponse est possible. Elle prend appui sur un fait saillant caractéristique des questions qui sont abordées dans les médias : leur caractère controversé. Un fait divers, tel qu’une attaque au couteau de la part d’un jeune, est diversement interprétable : insécurité ou résultat inévitable de suppression des budgets de l’éducation populaire ? Les explications sont diverses et ont généralement un lien avec les intérêts de celles et ceux qui les formulent – femmes, jeunes, commerçants, associations, etc. Comprendre le fait et pouvoir l’expliquer implique de faire une place à l’interprétation, laquelle procède de la confrontation de points de vue antagoniques. Les faits ne parlent pas d’eux-mêmes de manière univoque.
La méthode des juges
Comparons avec ce qui se passe dans un tribunal. Aucun juge ne se prononce sur le simple établissement des faits. Qui serait capable de les présenter de manière neutre ? Personne.
Le juge écoute donc, tour à tour, la défense, l’accusation et les témoins. Chacun d’entre eux produit les faits qui leur paraissent pertinents et significatifs. Un arbitre procède de la même manière, quand il doit rendre une décision. Il ne se contente pas de constater. Il écoute un point de vue, un autre, fait appel éventuellement au replay, etc. et finit par trancher.
L’interprétation prend du temps, et c’est elle qui passe à la trappe avec la prétention de « s’en tenir aux faits » ou, pis, avec la tentation de verser dans la chasse au scoop et le souci de « faire de l’audience ». Tout fait un peu complexe implique qu’une enquête soit menée pour pouvoir être compris. C’est la règle. Sans cela, ce n’est pas le tribunal de la vérité qui est dressé, mais la conclusion hâtive, voire le procès stalinien.
La question de la formation du jugement en situation controversée se pose aussi pour les enseignants. La question a donc fait l’objet d’un travail de deux ans impliquant une vingtaine d’enseignants de l’Institut Mines-Télécom, enquêtant, par exemple, sur les normes sur lesquelles s’appuient les juges, les arbitres, ou encore les enseignants confrontés à des controverses.
Trois normes procédurales se dégagent de l’analyse. La première est la neutralité. Un bon jugement ne doit pas chercher à changer les faits ni même les interprétations que les diverses parties en donnent. Il s’interdit d’interagir avec eux. La seconde est l’impartialité. À la manière d’un juge ou d’un arbitre, elle enjoint d’écouter tous les points de vue afin de construire une vision partagée de la situation. Ce résultat ne se trouvait dans aucun d’entre eux, pris de manière isolée. C’est pourquoi l’impartialité ne se confond pas avec la neutralité. Le troisième critère est l’objectivité. Les faits sur lesquels les points de vue raisonnent doivent tous être solides, à la manière des preuves jugées recevables dans un tribunal. Et leur solidité dépend de la manière dont le sujet et l’objet ont interagi.
Quelle est la méthode, alors ? Tout d’abord, ne pas confondre l’information avec le militantisme, le fait d’informer avec le fait de vouloir changer la situation. C’est la neutralité.
Ensuite, confronter les principaux points de vue, sans négliger les « signaux faibles ». Quand un point n’est traité qu’avec un seul expert, et plus encore si cet expert est toujours le même, ou quand des faits similaires sont abordés en donnant toujours la parole aux mêmes, alors nous sortons des critères d’un bon jugement. Par exemple, ne s’intéresser à une grève qu’en donnant la parole aux usagers mécontents revient à dresser un argumentaire à charge contre les grévistes, dont la parole n’est pas relayée. Et cela vaut aussi pour les scientifiques. L’océan du climatologue est bien différent de celui du spécialiste des requins.
Enfin, s’assurer de la solidité des faits, de leur résistance, en ayant en tête que les scientifiques sont bien souvent en désaccord entre eux. Ces trois normes sont ce que Kant appelait des « idées régulatrices », c’est-à-dire des idéaux qui indiquent des directions mais ne peuvent jamais être parfaitement réalisés.
Les médias classiques assurent-ils une information de meilleure qualité que les réseaux sociaux ?
Chacun pourra constater à l’aune de ces trois normes que les médias classiques (télévision, presse) ne sont pas forcément de meilleure qualité que les réseaux sociaux. Ils ont une ligne éditoriale, c’est-à-dire une manière générale d’interpréter la réalité, qui diffère d’un média à un autre. Ils vont donc avoir tendance à inviter les experts qui la confortent, à accumuler les faits qui vont dans leur sens et à mettre en doute ceux qui la remettent en cause.
Le gendarme de l’information veille, certes, aux abus les plus évidents. Ainsi, c’est pour avoir trop réduit la diversité de ses sources que la chaîne C8 a été interdite d’antenne.
En réalité, il est rare que les médias mentent ouvertement. La ficelle est trop grosse, et nuirait très fortement au média dès lors qu’elle serait dévoilée. C’est par le manque de neutralité et d’impartialité que passe la plus grosse des fake news. Les règles du storytelling le savent bien, d’ailleurs. Une bonne histoire doit être crédible, du point de vue du public récepteur. Et une belle histoire est bien plus difficile à remettre en cause qu’un fait qui se révélerait erroné.
Le raisonnement qui vaut pour les médias vaut aussi pour l’expertise, puisque celle-ci a pour but d’éclairer la décision. Si l’information apportée n’est ni neutre, ni impartiale, ni objective, alors la décision ne le sera pas non plus. Les mêmes règles doivent donc procéder au choix des experts dans une prise de décision.![]()
Fabrice Flipo, Professeur en philosophie sociale et politique, épistémologie et histoire des sciences et techniques, Institut Mines-Télécom Business School
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.