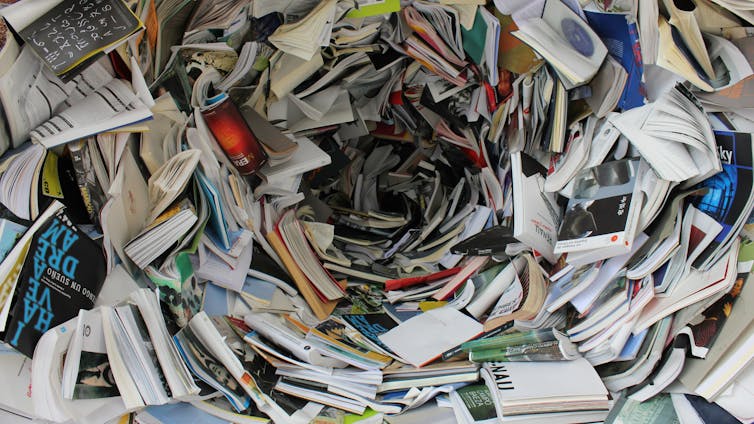
Qui aurait pensé qu’un jour les intelligences artificielles génératives rédigeraient, corrigeraient et seraient publiées ? Que vaut une littérature née sous IA ? Que devient notre imaginaire sous leur influence ? Et quels bouleversements sont à prévoir dans le monde de la littérature dans les années, ou les mois, à venir ?
Dans son essai Quand l’IA tue la littérature (PUF, 2025), Stéphanie Parmentier examine la place qu’occupent dans le domaine littéraire ces nouvelles marchandes de prose que sont les IA. Extraits.
Lorsqu’il écrit un manuscrit, un auteur cherche très rarement à le conserver uniquement pour lui-même. Dans son for intérieur, sans toujours oser se l’avouer, il espère que la qualité de ses récits captivera des lecteurs toujours plus nombreux.
Dans le circuit du livre, ce sont en effet ces derniers qui dictent l’espérance de vie d’une création littéraire, malgré le rôle majeur que jouent les éditeurs, les distributeurs ou encore les libraires dans la valorisation d’une publication. Les avis des lecteurs et leur comportement d’achat vont souvent contribuer à asseoir la carrière d’un auteur et la longévité d’un livre. Loin d’être de simples acheteurs passifs, les lecteurs possèdent un pouvoir de prescription, qui ne cesse de s’étendre jusqu’à s’imposer au monde des éditeurs.
Les nouveaux supports de communication apportent des repères inédits et redéfinissent les accès à la notoriété. Un lecteur n’a plus besoin d’adresser un courrier à un éditeur pour exprimer sa satisfaction ou sa déception après avoir lu un livre, il peut partager instantanément ses émotions et ses analyses auprès de milliers d’autres lecteurs en toute simplicité.
Depuis les années 2000, les supports permettant de donner son avis sur une publication n’ont cessé de se diversifier. L’apparition des blogs de lecteurs, des espaces de ventes de livres en ligne comme ceux de la Fnac ou d’Amazon, mais aussi des sites de partage de lectures de type Babelio ou Gleeph, sans oublier les réseaux sociaux, offre à de nombreux lecteurs la possibilité de mettre en avant leur coup de cœur, tout en exprimant leurs avis sur leur lecture ou en leur attribuant une note de satisfaction.
« Des personnes passionnées du livre et de la lecture ont investi sans retenue le net et les réseaux sociaux créant une nouvelle “sociabilité littéraire”. […] Pour elles, écrire, lire, et conseiller tout en communiquant sur ces pratiques, pourtant personnelles, sont devenus des comportements courants au point de faire naître de véritables prescripteurs littéraires. », peut-on lire dans les Cahiers du numérique en 2022.
Qu’il s’agisse des BookTubeurs, Bookstagrameurs ou BookTokeurs, ces nouveaux acteurs, appelés communément « influenceurs littéraires », avec leurs vidéos toujours plus animées pour exprimer leurs coups de cœur, occupent une place importante et inédite dans le processus de promotion d’une parution. À l’ère numérique, le pouvoir des lecteurs n’a en effet jamais été aussi grand. Ils peuvent découvrir, partager et promouvoir des œuvres, comme l’explique Chris Anderson dans la Longue Traîne, en soulignant tout le potentiel des consommateurs : « Ne sous-estimez jamais la puissance d’un million d’amateurs qui ont les clés de l’usine. »
Un équilibre constructif et bénéfique s’est établi entre les nouvelles technologies numériques et les plaisirs du lectorat. L’introduction d’IA dans la production littéraire risque pourtant de compromettre l’appréciation des lecteurs confrontée aux interférences d’algorithmes. Face à l’immixtion d’IA dans plusieurs champs littéraires, le lectorat ne semble pas encore réagir. Que pensent les lecteurs des livres nés sous IA ? Vont-ils les défendre ou au contraire, les dévaloriser ? Pour le moment, il n’y a pas encore de réactions d’adhésion ou, au contraire, de désapprobation.
La réception de textes générés par l’IA ne laisse pas pour autant les lecteurs indifférents ; elle induit des réserves et une perception plutôt sceptique. Les personnes attachées aux valeurs fondamentales de la littérature semblent les plus attentives. Redoutant les textes produits par des IA, certains lecteurs n’hésitent pas à exprimer leur crainte, notamment sur le réseau social Reddit :
« Pour moi, le problème principal est qu’en tant que lecteur, c’est que je ne veux pas lire quelque chose qui provient d’un ordinateur. Les livres sont un moyen de se connecter aux autres. Vous pouvez vous connecter à la vision du monde d’un auteur et voir comment son expérience se chevauche avec la vôtre. Il y a une sorte d’humanité partagée dans la lecture de fiction, un sentiment de compréhension et d’être compris. Appelez-moi romantique, mais je pense que c’est une grande partie de la raison pour laquelle nous lisons. Ce n’est pas seulement pour tuer le temps. Ça ne marche pas s’il n’y a pas de personne derrière les mots. »
Quand l’utilisation des IA n’est pas mentionnée dès la page de couverture, les lecteurs sont souvent désabusés en découvrant l’implication des robots génératifs au fil de leur lecture. Sur le réseau Babelio consacré à la littérature, un lecteur, malgré ses doutes, témoigne de la stupeur éprouvée en lisant la bande dessinée Mathis ou la forêt des possibles de Jiri Benovsky évoquée plus haut et dont les illustrations relèvent de l’IA :
« L’histoire commence donc et au bout de quatre ou cinq pages, je trouve qu’il y a quelque chose qui cloche, malgré la beauté époustouflante des images, je ne ressens pas la vie dans cette histoire, les personnages semblent figés, comme s’ils posaient pour la photo, une impression morbide, les textes sont dans des phylactères formatés, presque toujours la même longueur, le rythme est raide et plat. […] À la dernière page, je me suis dit : “c’est joli”. Ce n’est pas un compliment, généralement, j’utilise ce mot péjorativement. À la fin, on y trouve une postface, et sa lecture me laisse sur le cul ! […] Je découvre, avec cette postface, que cette bande dessinée a été réalisée à l’aide d’une intelligence artificielle ! »
Ces deux exemples ne sont pas isolés. Le malaise exprimé est commun à beaucoup d’autres lecteurs, devenus méfiants à l’égard de nouvelles publications dont l’identité de l’auteur n’est pas connue.
« Comment faire l’effort de lire un tel ouvrage [Internes] quand on ne sait pas quelle est l’origine du discours et ce qu’on lit ? », interroge l’auteur expérimental Grégory Chatonsky en évoquant son livre Internes. Soupçonneux à l’égard des créations littéraires qu’ils ont sous les yeux, les lecteurs tendent à modifier leur comportement. Auparavant, ils lisaient un texte écrit et validé par un esprit humain, avec l’ambition d’en savourer toute l’originalité, en toute confiance. Les lecteurs les plus avisés ont tendance à se métamorphoser en « lecteurs-scan » à la recherche de la moindre trace d’IA « fake text », car, si les robots conversationnels demeurent en général inapparents, leur patte, en revanche, est perceptible.
La perte de repère qu’entraînent les IA déstabilise la lecture et peut engendrer une certaine inquiétude chez les lecteurs, comme l’explique la chercheuse Erika Fülüop :
« Cette perte d’orientation peut donner au lecteur l’expérience d’une “inquiétante étrangeté” : les textes semblent “humains”, mais on sent un petit décalage difficile à saisir. »
Il est difficile de dire quelle attitude doivent adopter les lecteurs devant des textes « IA-géniques ». Leur faut-il systématiquement les rejeter au risque de passer à côté d’une littérature expérimentale capable d’enrichir le domaine littéraire ? Pour certains, il faut accepter ces textes malgré leur structure inhabituelle. Selon Grégory Chatonsky :
« Dans ce contexte, c’est la possibilité même d’un contrat de lecture qui est déconstruit. […] La seule façon de lire ce roman [Internes] est peut-être de suspendre la croyance en un contrat de lecture : lire sans préalable, sans attente, sans horizon. J’aimerais y entendre l’impossible des possibles. Cela est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. »
En dépit de l’atmosphère déstabilisante dans laquelle se trouvent les lecteurs, certains d’entre eux affirment apprécier les textes relevant des IA. Des lecteurs écrivent des avis positifs à propos de livres générés par des IA, notamment celui de Raphaël Doan, coécrit avec une IA, intitulé Si Rome n’avait pas chuté. Sur le site Babelio mais aussi sur Amazon, plusieurs lecteurs s’enthousiasment à propos de ce roman d’anticipation, comme, Jean J. :
« Au-delà des illustrations par IA, le texte est surprenant. […] L’IA (et le coauteur humain peut-être) propose une idée radicalement neuve : une révolution industrielle qui aurait pu être plausible. Elle se débarrasse froidement des “sciences humaines” et attaque directement dans le dur. Et ça fonctionne ! »
Devant le doute que soulève l’immixtion de l’IA dans l’écriture, des chercheurs de l’université de Pittsburg ont mené une étude dont les résultats ont été publiés dans Scientific Report. Leur démarche visait à évaluer la capacité des lecteurs à distinguer des poèmes écrits par des humains de ceux générés par ChatGPT 3.5. Selon les conclusions tirées, il n’est pas simple pour les lecteurs de discerner ce qui relève d’une production humaine ou d’une création artificielle :
« Contrairement à ce qu’indiquaient des études antérieures, les gens semblent aujourd’hui incapables de distinguer de manière fiable la poésie générée par l’IA […] de la poésie écrite par l’homme et rédigée par des poètes bien connus. »
Plus surprenant, les chercheurs révèlent un phénomène inattendu, puisqu’une partie des participants préfèrent les poèmes générés par l’IA à ceux créés par des esprits humains. Pour expliquer un tel résultat, les rapporteurs de l’étude supposent que ce ne sont pas les qualités littéraires des textes générés par le robot génératif qui sont appréciées par les lecteurs mais leur facilité de lecture :
« Les gens évaluent mieux les poèmes générés par l’IA […] en partie parce qu’ils les trouvent plus simples. Dans notre étude, les poèmes générés par l’IA sont généralement plus accessibles que les poèmes écrits par des humains. »
Pour l’heure, à défaut de données précises, des nuances et des réserves s’imposent.
L’opinion n’est pas unanime, mais il serait prématuré de parler de fragmentation entre lecteurs et textes dopés à l’IA, du moins aussi longtemps que le phénomène « IA-génique » reste contenu. Sur le fond, il y a matière à rester optimiste, car il appartient aux lecteurs, sans oublier les éditeurs, de réguler la pénétration de ce type de publication dans le monde du livre. Jusqu’à présent, comme l’indique l’auteur Mark Dawson, cité par la journaliste Marine Protais :
« Si un livre reçoit de mauvaises critiques parce que l’écriture est ennuyeuse, il va rapidement sombrer. »
« Enfin… Sauf si d’autres bots se mettent à noter positivement les livres de leurs collègues – hypothèse moins absurde que ce qu’on pourrait croire. »
Quand l’IA tue la littérature, Stéphanie Parmentier, Presses universitaires de France, hors collection, paru le 8 octobre 2025.![]()
Stéphanie Parmentier, Chargée d'enseignement à Aix-Marseille Université (amU), docteure qualifiée en littérature française et en SIC et professeure documentaliste. Chercheuse rattachée à l'IMSIC et au CIELAM, Aix-Marseille Université (AMU)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.